ISEE ET LES DEUX VISAGES. Partie 1.Ruth, je l'adorais...
A Boston, au 18°siècle, Ruth, jeune fille de la bonne société va se marier. Isée invente ce personnage impétueux pour plaire à Phillip Hammer, qui aime les histoires...
J’imagine que le futur époux de Ruth fut ravi par tant de candeur. Cette jeune fille portait, selon lui, un prénom prophétique : en hébreu, en effet, Ruth signifie « compagne ». Elle semblait d’emblée lui accorder une telle confiance qu’il eut l’intuition qu’elle serait sienne, vraiment sienne, donnant alors toute sa signification à ce prénom dont il ne savait si ses parents l’avaient choisi à dessein. La confiance et la fidélité inondaient de toute façon cette famille. Quand il vit à quel point étaient solides les mariages des frères de son épouse, il fut convaincu que le sien aurait des bases très solides.
J’inventai une seconde missive de Ruth. Elle s’adressait de nouveau à son mari mais cette fois, elle avait pris de l’âge et avait été mère plusieurs fois.
« Mon cher époux, vous m’honorez vraiment de votre confiance en me livrant vos pensées. Vous êtes négociant et je sais combien votre profession est devenue difficile depuis que nos maîtres anglais font preuve d’une autorité que vous jugez, très à propos, déplacée. Il ne s’agit pas tant de faire des affaires (et Dieu sait à quel point pour ce qui concerne le bois, la farine et la viande, vous n’avez pas votre pareil), il s’agit de travailler de manière gratifiante. Entre ces taxes, ce discret mépris et ces ordres qui s’enchaînent, voilà qui est difficile ! Dieu est votre guide et je ne doute en aucun cas de sa probité. Il saura vous faire trouver l’attitude la plus juste mais aussi la plus ferme vis-à-vis des Britanniques qui traitent avec tant de légèreté les hommes d’affaires bostoniens ! Quant à moi, vous savez que je vous accorde depuis longtemps déjà tout mon soutien. N’hésitez pas à le solliciter si la fatigue et la lassitude parviennent à attaquer votre solidité et votre bon sens. Ruth est votre alliée quoi qu’il en soit.»
Pour tout dire, Ruth, je l’adorais. Comme dans sa jeunesse, elle brûlait de dire vraiment ce qu’elle pensait mais elle se mordait la langue. Ce n’était plus en elle le lutin qui voulait montrer toute sa drôlerie mais la femme avisée qui se souvenait des sermons de son père sur l’honnêteté et la droiture. Elle ne pouvait se permettre de dire à son mari de ne jamais manquer de fermeté, alors elle prenait d’autres biais. J’imagine qu’à son insu, elle lisait les gazettes qu’il avait abandonnées dans son bureau et qu’elle était bien plus au fait des contraintes imposées à Boston par l’Angleterre qu’il ne le supposait. De plus, lors des dîners qu’elle organisait pour lui avec la bonne société de la ville, elle était aux aguets. Elle ne perdait pas une des paroles des hommes concernant la stupide et provocante intransigeance de la couronne britannique, tout en gardant son air mondain. Cette oppression et cette colère montante des commerçants américains, elle l’avait comprise et elle était contente quand elle sentait chez eux un désir de vengeance. Bien sûr, elle ne disait rien et faisait mine de ne pas s’intéresser à ce qui lui parvenait de ces débats. Mais au moment où, après le dîner, les hommes se retrouvaient entre eux et qu’elle rejoignait les femmes, elle bouillait intérieurement. Il était clair qu’un conditionnement moins fort et une époque différente auraient eu raison de sa réserve en lui faisant afficher avec force ses convictions. En 1770, il lui était impossible de les clamer, aussi utilisait-elle des biais adroits qui lui permettaient de rester informée. Le très à cheval sur les principes Thomas Sheridan n’était pas vraiment dupe. Il aimait avoir une femme instruite qui n’en pensait pas moins mais savait rester à sa place. Aussi appréciait-il les messages cachés qu’elle lui envoyait dans des lettres parfois très factuelles…
Je ne vais pas m’étendre sur l’ensemble des missives que je lui fis écrire mais je voudrais tout de même en citer deux autres, adressées celles-là à monsieur William Beckford. Je ne les citerai bien sûr que partiellement. Dans la première, elle s’adressait à l’associé de son mari en termes polis, suite sans doute, à une invitation à dîner qu’il avait acceptée. Un lecteur extérieur n’aurait rien remarqué mais à l’évidence, madame Sheridan se laissait aller. Son interlocuteur avait dû dès le départ lui inspirer des sentiments extrêmes sur lesquels elle n’arrivait pas à mettre un nom. Et pour cause ! Elle avait un coup de foudre mais ne savait le nommer. Que pouvait-elle en ce domaine elle qui ne connaissait que l’amour de Dieu inculqué par son père ou la vénération qu’elle portait à son mari ! A moins que ce même lutin qui s’agitait en elle ne l’ait induite en erreur en édulcorant sa passion naissante. Bah, après tout, cet homme était désormais l’associé de son époux et elle devait reconnaître que tout étant aussi efficace que le précédent (tant pis pour lui s’il avait voulu faire cavalier seul), il était autrement alerte et séduisant ! Qu’y avait-il de mal à regarder un bel homme lors d’un dîner et à le remercier d’y avoir assisté ?
«Je tiens tout d’abord à vous remercier de nous avoir rejoint il y a trois jours au 115 Beacon Hill. Notre maison vous a plu et je m’en réjouis. Mon mari m’avait parlé de vous avec enthousiasme et j’avoue qu’après avoir fait votre connaissance, je partage celui-ci. Vous me permettrez de m’exprimer de façon franche et sincère. Je ne suis qu’une femme mais j’ai la confiance (encore ce mot !) de mon mari et je l’écoute avec une oreille attentive. Il est furieux des ingérences anglaises et j’ai aimé que vous le soyez tout autant. Colonies et terre nourricière ont des accords et, connaissant l’origine du peuplement de ces treize états américains, il n’est pas recevable que la couronne anglaise soit si récalcitrante à reconnaître la valeur de ses colons. Eh quoi ! Ni New York, ni Philadelphie ni Boston n’ont ni à rougir de leur prospérité ni à supporter que celle-ci soit entachée. Je me réjouis que de votre association avec mon mari. Votre naturel est bon. Quant à votre fougue, elle m’a fait grand bien ! Un gentleman si en colère ! Ah Dieu, c’était un bonheur ! Je vous prie de conserver votre fougue lors du prochain dîner auquel nous vous convierons. »

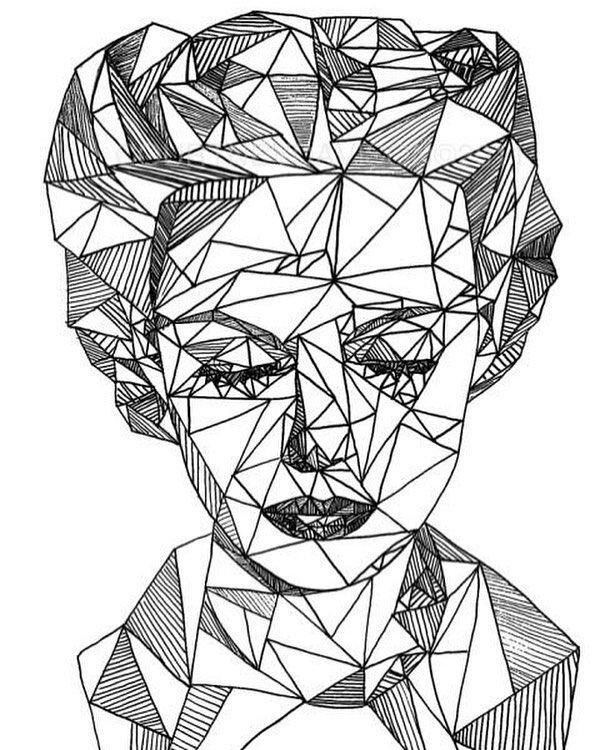


/image%2F1371598%2F20240418%2Fob_833780_acrylic-painting-of-a-beautiful-womans.png)
/image%2F1371598%2F20240418%2Fob_7827be_web-4-sebastien-dubois-180x215cm.jpg)
/image%2F1371598%2F20240418%2Fob_5e8c56_landscape-painting-father-and-son-more.jpg)
/image%2F1371598%2F20240418%2Fob_84421c_jeune-homme-colin.jpg)